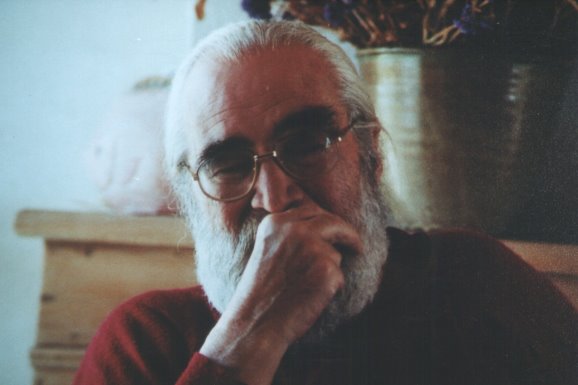Novembre 2000
Limoges
Pour bien parler du Rêveur rêvé, il faut partir de L’Autobiographe ou de La Vie impossible. Pour parler du Saint Néron, il faut partir de toutes mes tentatives depuis les 45 dernières années, pour aboutir aux Dieux étrangers. Il faut refaire tout le cheminement mythologique. Et pour arriver aux Litanies des dieux morts, il faudrait faire un recueil de tous mes poèmes pendant 30 ans. Ça pose le problème de la quadrature. La plus évidente, c’est la zodiacale, qui pose les 4 Cardinaux, mais la quête poétique est aussi posée sur les 4 : ce serait la forme, le sens, la régularité et l’irrégularité du vers, par exemple. Et puis L’Autobiographe, à travers ce qui est arrivé dans mon enfance, dans ma jeunesse, ce qui est arrivé dans ma vieillesse, jusqu’à l’extrême vieillesse, la sénilité. Donc on trouve les 4 âges, on trouve les 4 saisons, on trouve les 4 éléments, on trouve les 4 cardinaux… Bien que tout ça n’ait aucune existence, naturellement.
– Les 4 saisons n’ont pas d’existence?
On peut les nommer, mais… On pourrait faire toute l’interview sur les 4, ce qui est amusant puisque les 4 n’ont pas d’existence; c’est vrai que c’est d’eux qu’il est le plus aisé de parler. Mais c’est difficile en même temps. Si les ésotéristes en reviennent toujours aux 4, c’est que c’est plus simple, ça simplifie, ça éclaire la quête, bien que ça l’éclaire d’une manière puérile, d’une manière incomplète, d’une manière systématique, etc.
– Quand est-ce que sont apparus Pigobert et Jean-Baptiste?
Apparus? Pigobert et Jean-Baptiste, il faudrait d’abord en parler un petit peu. Ça ne dit rien, ces deux mots, ces deux noms. Je ne sais pas, j’ai l’impression que c’est apparu vers mes 10 ans, parce que jusqu’alors j’étais Jean-Baptiste. Oh, peut-être pas pendant mes 4 premières années, où je devais être un enfant très difficile; plus que de la violence, il y avait une sorte de recherche de l’absolu, qui s’exprimait d’une manière telle que mes grands-parents qui m’élevaient étaient certainement sans aucune défense contre cette quête. C’est très difficile de dire des choses aussi énormes, chez un enfant d’un an et demi, deux ans, mais de ce que je comprends de ce que m’ont dit mes parents et mes grands-parents, j’ai l’impression que c’était ça : c’était un combat entre la vie et la mort, à peu près constant. Et dès ma naissance, puisque je n’ai vécu que peut-être un quart d’heure, c’est incroyable. Après la sortie du ventre de ma mère, j’étais mort. Donc il a fallu me battre, il a fallu me fesser pour qu’enfin je pousse un cri. J’étais étouffé par le cordon ombilical, j’étais mort!
Donc, dès le départ il y a eu ce problème tout de même particulier de la vie et de la mort. Est-ce que j’avais répugné à sortir du ventre de ma mère, est-ce que j’avais eu peur de la vie? C’est délirant de dire une chose pareille. En tout cas, c’est le fondement de ma prime jeunesse. Ce qui la caractérise, ce qui a épouvanté tout le monde, c’est ma faculté de m’anéantir. On appelait ça des convulsions à l’époque. C’est-à-dire que quand on me refusait quelque chose, je tombais mort. Tu vois ce que ça peut produire sur des grands-parents. Et puis je revenais de ma convulsion. Ça semblait être un prélude à l’épilepsie, or je n’étais pas du tout épileptique. Pourquoi je tombais en convulsions, il n’y a pas d’explication médicale. Le fait est que c’était la grande terreur de ma grand-mère, entre autres. Je tombais inerte, et puis après, il y avait des soubresauts, je revenais à la vie. C’est très particulier, ça n’a rien de médical.
Alors on me laissait tout faire, évidemment, donc j’étais extrêmement libre, mes 4, 5 premières années furent d’une liberté extrême. Mais j’étais, en fin de compte, un enfant très docile. Paradoxalement, tout le monde me dit que j’étais très docile. D’ailleurs j’apprenais beaucoup, grâce à mon grand-père : il m’a appris les échecs, le piquet; il m’a appris le latin, même avant de parler, en quelque sorte. Et mon dieu, aux jeux faciles, je faisais des progrès.
Quand je suis allé à l’école, vers 4 ans ½, je n’apprenais rien – c’était une école de bonnes sœurs – je n’apprenais rien du tout, je savais tout d’avance… Et ça a été un peu ça jusqu’à 10 ans, c’est-à-dire que j’étais très en avance. Quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, où on m’a mis dans une école primaire, où j’ai vécu la ville, la domination, l’esclavage, j’étais un barbare, j’étais resté le barbare de mon enfance. Les maîtresses me détestaient par le regard. Je me souviens de cette phrase : « Me regardez pas comme ça! ». C’est un peu minable. Mais j’étais premier, non seulement premier mais j’ai sauté des classes parce qu’on n’avait rien à m’enseigner. Et j’étais un bon élève, j’ai eu des prix d’excellence, en 9ème, 8ème, 7ème. Non, je l’ai raté en 7ème. J’étais en tout cas un enfant docile, j’étais Jean-Baptiste. Je croyais en Dieu, je croyais dans la Justice surtout, d’ailleurs, et je n’avais pas de problèmes, sauf avec mes camarades, mais je les domptais tout de suite. J’étais quand même un sauvage et je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Dans les classes j’étais un élève docile, et dans les récréations j’étais une brute, c’est clair, je gagnais sur tous les plans.
– Pourquoi est-ce que tu as été élevé par tes grands-parents?
J’ai été élevé par mes grands-parents parce que mon père – tu sais, c’était la grande vogue de la tuberculose à l’époque – on a décrété que mon père était tuberculeux, donc menace de contagion, etc. Et mes parents, donc, m’ont laissé chez mes grands-parents au Croisic, dans les rochers, la mer, et puis lorsqu’il s’est révélé que mon père était guéri, alors mes parents m’ont repris à l’âge de 5 ans.
Et ils m’ont plongé… – donc c’était la ville ouvrière, c’était la ville mécanisée, c’était Saint-Nazaire, ça a été l’école primaire, ça a été l’horreur certainement au début. Je me suis sauvé je ne sais pas comment, parce que ça devait être très difficile à cinq ans. Je me suis sauvé par la recherche d’un objet, la recherche d’objets personnels : je me souviens d’un couvercle de boîte de camembert que je cachais soigneusement. Et le jour où on l’a découvert sous la table de la cuisine, ça a été terrible pour moi. J’avais comme ça des repères, certainement des productions pour moi. Je ne vois pas ce qui a pu me sauver, sauf ce qu’il y avait de bon en moi, c’est le côté angélique. Quand je faisais un rôle dans une procession, je faisais toujours l’ange – et j’étais un ange, j’avais d’ailleurs des cheveux blonds, très bouclés, je n’étais pas du tout ce que je suis devenu, vraiment le brave gosse, il n’y a pas de doute.
– Tu as eu compagnon, un animal?
C’est plus que ça, ce n’est pas un compagnon. Non, dans la mesure où je n’avais pas ma mère, j’ai été nourri au lait de chèvre, et cette chèvre était plus que mon compagnon, Biquette c’était ma mère. Et c’était vraiment plus que l’amour, la nécessité, l’existence profonde de mes premières années. Oui, c’est important de dire ça, que j’ai été nourri par une chèvre.
A partir de dix ans, donc, neuf ans même, jusque-là j’avais toujours eu des prix d’excellence et à la fin de ma 7ème, le dernier trimestre, le professeur que j’aimais beaucoup – c’était un mathématicien avec qui j’avais déjà des discussions passionnantes, à propos des fractions – est parti, parce que c’était un professeur excellent et qu’il avait une agrégation quelconque, il ne pouvait donc pas continuer à enseigner dans un collège religieux de Saint-Nazaire. Il a été remplacé par une conne, qui tout de suite m’a pris en grippe : « Ne me regardez pas comme ça! », etc. Et il s’est passé cette chose étonnante, vraiment étonnante, qu’un jour je me suis réveillé avec une fièvre intense, et puis vraiment très mal en point. Ma mère, évidemment, m’a dit : »Tu vas aller à l’école? – C’est l’épreuve finale, je ne vais pas rater mon prix d’excellence. – Mais tu pourras? – Mais oui, mais oui ». Il faut dire qu’il y avait un kilomètre de chez moi à l’école. J’ai fait ce kilomètre, j’ai fait toute l’épreuve et puis tout à coup je me suis levé, je crois même avant la fin – la maîtresse n’a pas aimé – et puis je suis tombé. Comme j’étais pratiquement inerte, on m’a emmené à l’hôpital, on a cru que c’était une méningite. En fin de compte, c’était une simple angine. Mais enfin j’avais 41° de fièvre tout de même. Bon, on m’a ramené à la maison et au bout de cinq, six jours, je suis retourné au collège; et c’était le jour où on donnait les résultats de l’examen. Je m’attendais à être premier, bien sûr, comme toujours; or, pas du tout : ni second, ni troisième, ni quatrième, ni cinquième, etc., et, à la fin, la maîtresse a dit : « Et puis Pichon, 0, ça t’apprendra à copier. » Comme si un gosse qui a 40° de fièvre pouvait copier!
Je ne sais ce qu’elle avait imaginé. Elle disait : « Tu te tournais vers ton voisin, je l’ai bien vu! » En effet, j’oscillais de la tête à droite et à gauche. Enfin il n’y a rien eu à faire, j’avais zéro, je n’ai pas eu le prix d’excellence. Et ça j’ai souffert énormément de cette injustice, je n’ai pas compris. Tout le monde a essayé de m’expliquer, mon grand-père, mon père me disant : « Mais ça arrive, c’est la vie, etc. ». Ça a été un choc épouvantable pour moi. Je n’avais jusqu’alors jamais douté que la Justice existait.
Et à la rentrée en 6ème, j’ai un professeur sadique, fou. La folie n’était pas tout de suite évidente en octobre, enfin il avait quand même une attitude de fou. Il voulait que prononce les « u » « ou », à la cléricale. Moi, je disais « u », à chaque fois c’était des pensums… Et puis ce gars avait l’habitude de fesser les gens, pour le moindre prétexte. Et moi j’étais – je le dis dans Reliefs -, c’est ce que dit Edgar Poe : « la découverte de l’horreur par le mal réalisé ». On m’avait parlé du Mal jusqu’alors, mais je ne le voyais pas. Or, ce professeur était le mal absolu. C’était le mal réalisé. Je ne sais ce qu’il s’est passé, je ne peux pas dire que j’ai fait ce que j’ai fait par justice ou rien, j’étais un peu détraqué. Ou quelqu’un me guidait peut-être, je n’en sais rien, en tout cas Pigobert est apparu à ce moment-là.
Et il a fait une chose effroyable, dans tous les sens du mot. A Noël, j’ai eu un zéro. J’en avais marre des zéros, je ne pouvais plus supporter le zéro. Il y avait un chemin direct pour aller à l’école, puis il y avait un chemin oblique par les faubourgs, par où on n’avait pas le droit de passer, on ne le prenait pas, bien sûr. Et ce jour-là j’ai pris ce chemin oblique, je me suis arrêté devant une maison, sur le bord d’une fenêtre, j’ai sorti mon cartable, sorti mon carnet de notes. J’ai pris une grosse gomme violette qui laissait des traces partout et j’ai effacé le zéro. Je n’ai même pas fait un 9 ou un 6, c’est ça qui me frappe toujours quand j’y repense, j’ai fait un 7. Est-ce que je pensais mériter 7, je n’en sais rien. Alors, revenu chez moi, bien sûr c’était trop évident : « Qu’est-ce qui s’est passé? » Et j’ai donné mon voisin de table. J’ai dit : « On m’a remis mon carnet avec retard, c’est mon voisin, c’est lui qui a du le faire… » Moi je n’avais jamais menti. Jamais, jamais. « Je suis rentré par la voie régulière, j’ai rencontré tel professeur, le professeur d’histoire, etc. » J’ai raconté toute une histoire invraisemblable. Mon père m’a cru : je n’avais jamais menti.
Il m’a accompagné le lundi, il a essayé d’expliquer les choses, c’était vraiment un drame effroyable; c’était un drame parce que le professeur d’histoire, évidemment, ne m’avait jamais rencontré sur le chemin. Il m’a donné ma première fessée. Mais bon, c’était un type bien, ce n’était pas un sadique du tout; bon, c’était une école religieuse… Mais en tout cas, je n’ai pas cédé, je l’avais bien rencontré. Et puis les élèves ont commencé, parce qu’ils en avaient marre de ma dictature sauvage; ils ont commencé de m’étirer les bras, les jambes, de m’écarteler sur les arbres. Et puis, peu à peu, mon professeur sadique a commencé par me battre, me fesser d’abord en public, puis après la classe en me faisant déculotter, etc. Et je ne disais rien, ni à mes parents ni à personne. Ma mère disait que je m’endurcissais. Personne ne se doutait de ce que j’éprouvais, de ce que je ressentais. Et ça a duré depuis janvier jusqu’au milieu d’avril. Je ne sais pas comment ça aurait fini, mais un jour le professeur de musique – c’était une femme – est entrée dans la salle où l’abbé me battait, avec des yeux de fou. Il m’avait quand même presque cassé un bras. J’étais couvert de meurtrissures. Mes parents n’avaient rien vu. Je crois que c’est resté en moi quelque chose de très profond : comment, pendant trois mois, ils n’ont pas du tout pu voir ce genre de supplice? J’avais obtenu de ma mère qu’elle me donne des bottes, des bottes qu’on portait à l’époque, avec des boutons sur le côté, pour me protéger les cuisses. Mais je ne disais absolument rien. Alors évidemment, ce professeur de musique s’est précipitée chez le Supérieur et, en fait l’abbé est parti à l’asile le lendemain. Moi, on m’a soigné un petit peu, à la clinique, et puis mon père a dit : « Non, il ne restera pas ». On m’a mis dans un lycée laïc.
C’est quand même un signe de… aussi anormal que les autres… d’une sorte de… le monstre apparaît là : le voyou, l’endurci, le féroce. Je compare ça tout à fait à Edgar Poe, dans le naufrage, où le gars, quand il sort de son isolement, de sa cellule, parce que c’est un passager clandestin, Gordon Pym, et bien il arrive en pleine révolte sur le bateau. Le mal suscite le mal. Combattre le mal, même individuellement, ça crée un chaos, une chose absolument abominable. J’avais senti que le mensonge, quand il est poussé au bout et avec une ténacité aussi grande, si idiot soit-il, il l’emporte. Je me souviens du mot du Supérieur, à la fin de cette histoire, quand je suis parti : « Evidemment nous regrettons, l’abbé a eu des, des… il a fait la guerre, il a été gazé, il était malade, on n’aurait pas dû lui donner ce rôle de professeur. » Parce qu’il était évident qu’aucun enfant n’est si pervers qu’il puisse tenir dans ces conditions pendant trois mois. (Rire).
Voilà. A partir de ce moment, il y a eu en moi les deux. Il y a eu évidemment Jean-Baptiste et Pigobert.
J’ai fait de mauvaises études, en fin de compte. Au moins pendant deux ans, 6ème, 5ème, j’étais dans un état de vide, de désert. (…)
La première fois qu’au collège laïc, au lycée Briand, il y a eu une composition de mathématiques, moi je n’ai rien fait. Et au bout des trois heures, j’allai rendre ma copie blanche au professeur. J’ai dit : « On ne m’a pas enseigné ça ». Evidemment, ce n’était pas le même enseignement. Le type était fou : « Ah! Voilà bien ces curés, ces curetons! » Voilà bien la croyance et la non croyance. C’était le désert absolu. Michel, mon fils, a vécu ça après, quand il a été mis en pension à Stanislas; il avait zéro, zéro, zéro, parce qu’il fallait qu’il quitte la pension. C’est une force, une force extraordinaire chez un adolescent.
En tout cas, peu à peu, ce qui m’a sauvé c’est un professeur – au pair, le professeur Rousseau – en 4ème seulement, en fin de 4ème, qui nous a découvert la poésie. Là il s’est passé quelque chose, au moins d’extraordinaire : j’ai découvert que le mensonge gagnait, mais si c’est le mensonge du poème il gagne en tout, il gagne avec raison, à ce moment-là. Je suis devenu poète à partir de là. Et puis ça a duré, j’étais toujours en avance malgré tout sur mes professeurs, j’ai passé mon premier bachot à quinze ans. Peut-être un peu tôt : j’étais nul en physique, alors j’ai échoué à mon premier bac, et j’ai renouvelé ma 1ère.
Et ça, ça a été une chance extraordinaire, parce qu’il y avait un garçon, que je n’avais pas tellement vu la première année de 1ère, d’ailleurs il n’était pas dans ma classe, et qui a été dans ma classe la seconde année. Il était aussi très jeune, il devait avoir 15 16 ans aussi, il s’appelait André Ross et il était le fils d’un professeur technique, qui n’était pas du tout intellectuel, mais qui avait fait – je me souviens d’une conférence, entre autres, sur la différence entre l’idéalisme et le réalisme d’une part, et d’autre part, le kantisme disons et le cartésianisme – et cette conférence m’avait ébloui. Bien que ce soit un professeur technique, c’était certainement un être très extraordinaire. Et son fils, André Ross, était aussi un être extraordinaire : un petit bonhomme roux, à lunettes, mal fichu physiquement; moi j’étais grand, et plutôt bagarreur. J’aurais pu faire du sport, je n’en faisais pas. Lui qui ne pouvait pas en faire, aurait voulu en faire. Et puis c’était un homme d’une intelligence tout à fait supérieure, qui écrivait, à quinze ans, un traité sur l’économie future des peuples de l’Europe (1935), où il analysait comment, par le partage de l’Europe en pays arbitraires, en 1918, s’était creusé un abîme dont on ne pourrait pas sortir, mais qui disait tranquillement : « Il a fallu une guerre pour donner au peuple juif un foyer en Palestine, il faudra peut-être une autre guerre pour lui donner un Etat ». Il disait ça à quinze ans.
On étudiait Rimbaud, on découvrait Lawrence, Les 7 Piliers de la Sagesse, et puis on découvrait tout ce que les professeurs ne nous enseignaient pas, c’est-à-dire Einstein, Planck, ou bien le surréalisme… On se voyait tous les jours et le jeudi, où on avait journée libre, on partait en vélo, près de Saint-Nazaire, au Rocher du Lion, entre Saint Marc et Sainte Marguerite, et là, dans le vent, contre le rocher, on analysait les évènements de la semaine. On inventait la théorie des Surcauses, c’est-à-dire qu’à la causalité scientifique et rationnelle, on opposait une autre vision du monde qu’on appelait le monde des Surcauses, où la cause n’aurait pas été avant, mais en quelque sorte après. A quel point j’étais un salaud, c’est que – donc on a vécu ça deux ans – et quand on a eu nos bacs tous les deux, moi j’étais tombé amoureux d’une fille qui s’appelait Odile, et puis j’allais partir pour Rennes, où j’allais être étudiant en droit, j’avais dix-sept ans, et bien j’ai quitté André Ross, ce qui prouve quand même chez moi, je ne sais pas ce que c’est, toute ma vie j’ai comme ça laissé les gens aussi facilement que je me précipitais sur eux. C’est quelque chose d’assez effroyable, je pense qu’il a été très malheureux. Je n’ai pas réalisé sur le moment. Il était trop orgueilleux pour me l’exprimer, mais ça a dû être terrible pour lui.
– Vous ne vous êtes pas revus?
Si, tu vas voir dans quelles circonstances. Mais j’indique ça parce que c’est un trait qui me suit toute ma vie, c’est Pigobert. Pigobert, par moments, l’emporte sur Jean-Baptiste. Pigobert fait ce qu’il a à faire, le reste il s’en fout.
Donc j’allais à Rennes, puis j’avais cette correspondance avec mon amie Odile, qui était à Fontenay aux Roses près de Paris. Et là j’ai essayé différents trucs, j’étais aux Jeunesses Etudiantes, j’ai fait des conférences pour les ouvriers, pour les étudiants malheureux. Et j’avais quelques bons amis, mais en fait je m’emmerdais terriblement, dans cette faculté de droit. Il n’y avait que le droit romain qui m’intéressait, il n’y avait que le professeur de droit romain qui m’était sympathique. Je me souviens, un jour, à la bibliothèque où j’étudiais, il est venu, il m’a dit : « Vous voulez partir, aller à Paris? » J’ai dit : « Je vais partir, oui, oui. – Et pourquoi? – Parce que je veux partir. – Enfin, vous êtes à un mois de votre examen, vous êtes un bon élève. – Je sais, je sais. Mais je ne peux plus supporter ça. – Quoi, ça? – La vie qu’on me propose ». Et je suis parti à Paris. Je n’avais pas grand-chose, j’avais cent francs en poche. Là, j’ai découvert un autre monde, il y avait des poètes, des artistes qui sentaient très bien que ça allait être la catastrophe, d’ailleurs c’était en mai, juin 39. Et puis j’ai téléphoné à Odile, qui m’a dit : »Tu es fou, Jean, qu’est-ce que tu fais là? – J’en sais rien, ce que je fais, j’en ai marre ». Alors elle m’a dit : « Et bien où vas-tu? – Je suis sur un banc, je n’ai pas d’argent. – Prends un hôtel et je viendrai te voir demain ». Et je ne l’ai pas prise, je ne sais pas pourquoi. Elle me disait : « Toute la nuit, j’ai rêvé d’être ta maîtresse ». Là j’ai découvert que le visage des femmes est fait d’os, de dureté, de mollesse. J’ai joué avec son visage. Et puis j’ai essayé de vivre à Paris, je n’ai même pas pu publier une nouvelle que j’avais proposée aux Nouvelles Littéraires, je n’avais rien, je n’avais pas d’argent. Il y avait un ami, le patron de mon père, qui était à ce moment-là directeur commercial à Donges, qui est mort peu de temps après, pendant le bombardement de la gare de Rennes. Cet homme de 35 ans à peu près, m’a eu un métier, chimiste dans un laboratoire, j’y suis allé une ou deux fois, je ne savais plus ce que je faisais. Je quittais Paris, quelquefois j’allais me balader dans la banlieue. Là j’ai connu la faim, au bout de trois, quatre jours on a faim, quand même.
Je suis revenu à Saint-Nazaire, chez mes parents. C’était effrayant, ça n’avait pas de nom ce que leur avais fait, partir sans passer mes examens… J’ai fait un petit peu des boulots. J’ai été journaliste quand même, à La Baule, pendant deux mois. Je faisais des éditoriaux, des articles. Et je sentais bien que ce n’était plus possible, il y avait cette idée de guerre qui venait, il fallait faire quelque chose. Tout ça n’avait pas de sens. Il fallait se mettre dans un ordre quelconque, puisque l’Eglise ne suffisait pas, il fallait trouver autre chose. Tout ça c’est fou.
Enfin je me suis engagé dans la Marine Nationale… Ça aussi, c’est un signe absolu de Pigobert. Quelque temps après mon arrivée, j’étais à Lorient, il y avait un gars, un pauvre type, mais bien intelligent, et on passait nos moments de répit à discuter. Et je commettais le crime de dire à ce jeune : « Tu sais, quand on est dans l’armée, il n’y a qu’une chose à faire, c’est de déserter. Est-ce que tu es capable de déserter? » Pas fou, je n’ai pas déserté, moi! On l’a rattrapé tout de suite. Il était heureusement très intelligent, il avait compris mon enseignement : il a joué le fou. On l’a libéré deux jours plus tard.
Moi, on m’a envoyé à Rochefort pour être fourrier. Il m’est arrivé des trucs bizarres. Un jour je rencontre une putain, qui littéralement me saute dessus; je lui dis : »Je n’ai pas d’argent – Ça m’est égal. » Bon, je vais chez elle, puis je dis : »Mais je vais être puni, moi, je ne vais pas être à l’heure ». Et je fous le camp. (Rire). Voilà ce que je faisais à ce moment-là. Il y avait une copine que je voyais à Fouras, qui s’appelait Hélène et puis – j’avais cette idée en moi, que couvaient à la fois Pigobert et Jean-Baptiste, qu’on ne prend pas une femme qu’on n’aime pas. C’était une chose extraordinaire qu’il y avait en moi, aussi rigoureuse qu’autrefois au moment de la Justice. Alors elle m’en a voulu, mais à mort. Elle ne comprenait pas. Elle a lancé contre moi des petits marlous. Un autre jour, je participais à un incendie, alors je suis revenu sans mon bonnet; on m’a d’abord puni, puis on s’est aperçu que j’avais participé à l’incendie, on voulait me donner une médaille…
Je me suis retrouvé à Lorient, matelot fourrier 1ère classe. C’était une ville ouverte, j’en avais marre, et puis un matin, j’avais vu des officiers foutre le camp en voiture avec leurs poules, on nous dit : « Ben voilà, vous allez dans la cour, vous rendez vos armes d’abord ». Je me dis : « Qu’est-ce qu’il se passe? C’est pas possible! » Je suis allé dans la cour, je suis sorti et je suis allé au port. On affrétait des bateaux, j’en ai choisi un, j’ai eu des histoires avec des officiers. Et puis le bateau s’est échoué, parce que tout ça était très mal fait. Alors j’ai pris la route, fuyant devant les Allemands, désertant.
Quand je suis arrivé chez moi à Saint-Nazaire, ma mère m’a dit : « Mais qu’est-ce que tu fais là? Tu es en permission? – Mais pas du tout. – Tu désertes? – Ben voilà, je déserte. » (Rire).
La connerie a continué. Le lendemain, je suis allé me présenter à la Kommandantur, parce que je voulais créer un journal, simplement. (Rire). Et j’avais demandé, on m’a dit qu’il fallait une permission allemande. Alors j’y suis allé. « Qui êtes-vous, monsieur? » Malheureusement, j’avais parlé aux journaux du coin, le Journal de la Presqu’île de l’Ouest, je crois; ils m’avaient tout de suite dénoncé, bien sûr. Alors ils savaient bien que j’étais matelot. J’ai foutu le camp.
Et puis je suis allé à Nantes, j’ai un peu fui ici et là. Après j’ai fait du commerce de gravures, j’ai fait des choses, sous l’occupation je n’ai pas fait de résistance. Sauf à la fin, parce que je ne pouvais pas travailler. Je m’étais marié. Il faudrait que je te raconte mon mariage, mais il y aurait tant de choses à raconter…
J’avais une femme extraordinaire dans tous les sens du mot, géniale et folle à la longue, géniale au début, folle à la fin, qui était malade, qui se prétendait tuberculeuse, qui était peut-être malade, mais de quoi, les médecins n’en savaient rien. Alors, l’amour qui sauve de la mort, bon, on a vécu ça…
On a fait jouer une pièce, ce qui était incroyable en 40, au Théâtre des Noctambules, avec des grandes vedettes. Mais on ne pouvait pas vivre comme ça, alors je suis revenu à Redon avec ma femme, parce que ses parents vivaient à Redon. On a créé un magasin d’estampes et de gravures. J’allais vendre ça à travers la Bretagne. On montait des pièces, on a joué du Péguy sous l’occupation allemande.
Et je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas travailler, parce qu’il y avait mes parents, il y avait ma femme. Ma femme qui était géniale, mais qui était aussi la petite fille de ses parents et qui essayait quand même d’être une bonne ménagère – et qui était aussi dure comme ménagère que comme actrice, géniale comme actrice et parcimonieuse comme ménagère. Et puis les enfants qui venaient… Alors je ne pouvais plus travailler. Et, pour travailler, j’ai imaginé de foutre le camp. Je suis allé dans un petit bled près de Nantes, au bord de la Loire, où j’ai écrit mon premier roman, Les ruines. Et, quand je suis revenu, j’ai raconté que les Allemands m’avaient emprisonné, que je m’étais évadé du train. Tout le monde a marché. A ce moment-là, on a dit : ce n’est plus possible, il faut faire quelque chose. Alors mon père, qui était directeur commercial à Donges, aux Consommateurs de Pétrole, m’a dit : « Viens, viens jusqu’à la fin de la guerre. » Alors je suis rentré là, j’étais pompier. J’ai fait de la résistance, un peu malgré moi. Les employés, c’étaient des drôles de résistants, ils ne comprenaient pas, toute cette essence qui allait être perdue, c’étaient de braves types, de très braves types, ils volaient l’essence aux Allemands, ils passaient par-dessus le mur et je les aidais. On risquait notre vie. Mais on risquait pour quelques sous, pas pour rien. De temps en temps, quand même, on allait faire sauter un transformateur. Alors, comme j’étais, moi, celui qu’avaient enlevé les Allemands, qui s’était évadé, j’étais un héros, bien sûr. (1)
Et puis, il s’est passé cette chose extraordinaire aussi, c’est que, ma femme d’abord n’en pouvait plus d’être séparée de moi la moitié de la semaine – en fait, je travaillais six jours et je passais trois jours à Redon avec ma femme – et elle ne pouvait pas assumer toute seule la vente d’estampes. Elle voulait vivre à Donges. Tout le monde lui disait : « C’est fou! Ne viens pas à Donges maintenant, ça n’a pas encore été bombardé, mais ça va l’être. » Elle est venue avec sa famille, avec son père et sa mère, tout ça a rappliqué, à Donges, dans une maison à côté de chez nous. Et c’était atroce, parce que mes parents étaient des gens très simples, très humbles. Mon père était un ancien caissier qui, à l’aide de travail était devenu expert comptable. C’étaient des gens très simples. Alors que mes beaux-parents, ma belle-mère était la fille d’un sénateur, la sœur d’un général, donc il n’y avait pas de commune mesure entre les deux familles. C’étaient des scènes continuelles. Moi un jour j’ai dit : « Je ne mange plus jusqu’à ce que vous vous accordiez ». Je suis resté deux ou trois jours sans manger. (Rire). Et le jour où ils se sont accordés, il y a eu le bombardement de Donges. Tout a été anéanti, tout était en flammes. Alors j’ai dit : « Bon, il faut partir. » On est parti à travers les flammes. On avait deux enfants à ce moment-là, Christophe et Chantal. On est arrivé au bord du canal de Nantes à Brest. J’ai dit : « Ce n’est pas possible, il faut passer. On ne va pas rester là des mois. » J’ai volé toutes les valises de mes beaux-parents. Oh, il n’y avait pas grand-chose. Il y avait – ce qui m’a desservi – des Deutschemarks de 1920, que gardait mon beau-père. J’ai emporté ça en me disant : là, ils vont bien être obligés de me suivre. J’ai déposé ces valises chez quelqu’un près de la rive et je me suis mis en quête d’une voiture. J’étais très naïf aussi, parce que c’était quand même la liesse, c’était la libération de l’autre côté du canal. Dans un bistrot, on m’a fait promettre d’attendre, que j’allais avoir ce qu’il me fallait. Et puis ce sont les FFI qui sont arrivés. On m’arrête : j’étais un espion allemand. On trouve les Deutschemarks dans ma valise. On m’emmène à Guenrouët, où je tombe sur une autre sorte d’horreur : des pauvres gens, deux ou trois prisonniers, qui étaient des vieilles gens. Il y en avait un qui allait à Laval. Il voulait dire la ville, on avait compris l’homme. Moi j’étais fou. Je suis allé voir le colonel. « Vous n’allez pas permettre ça! – Mais qui êtes-vous? Ah oui, mais ça ne prouve rien, vos papiers, vous avez pu les voler. » J’ai fait venir le maire de Saint Nicolas de Redon, pour dire qui j’étais. En plus, il y avait un gars qui était là, un ancien compagnon de collège, qui était maintenant lieutenant FFI. Alors finalement, on me libère, bien sûr. Mais… faire quoi? Le gars – ça c’est des types étonnants – chez qui j’avais laissé les valises de mes beaux-parents, est venu me chercher en voiture. Il m’a dit : « Qu’est-ce que vous allez faire maintenant? – Je vais repasser le canal. – Ah non, ça c’est beaucoup plus difficile, il y a la mitrailleuse… – Tant pis, je ne peux pas faire autrement. » Alors je repasse le canal, j’arrive chez le paysan qui nous accueillait – je n’arrive pas jusque chez lui, parce que sur le chemin il y a un officier allemand qui dirigeait la région, qui me voit comme ça, mouillé de la tête aux pieds, et qui criais : « Où est ma femme? »
« Qui êtes-vous? – Pichon. D’où venez-vous? – De Redon. – Qu’est-ce que vous faites à Redon? – Commerçant. – Vous cherchez votre femme? Il y a combien de temps que vous n’avez pas vu votre femme? – Il y a deux ans. – Bon, ben votre femme, mon vieux, on l’a transportée avec sa famille de l’autre côté. – Bon. Merci. – Eh! [si vous traversez] on vous tire dessus! – Qu’est-ce que vous voulez que je fasse? J’y retourne. – On va vous reconduire. » Et ils m’ont reconduit en barque. Je n’avais pas besoin de la barque, ça faisait trois fois que je traversais le canal à la nage. Je suis allé dans une maison abandonnée, j’ai dormi sur un matelas. Je dormais même dans des moments comme ça. C’est incroyable. Je dormais. Le lendemain matin, il y avait un chien qui aboyait. J’ai suivi le chien et il m’a amené à ma femme et mes beaux-parents qui étaient dans une autre maison. J’ai demandé : « Comment as-tu pu passer? – J’ai servi les Allemands. – Tu as servi les Allemands? – Ils m’ont dit qu’ils me feraient passer si je leur donnais des nouvelles de deux jeunes de seize et dix-sept ans. »
On m’avait dit qu’il y avait un petit homme en rouge qui fouinait… c’était ma femme. Elle était revenue leur dire qu’il y en avait un qui était blessé, à l’hôpital, et l’autre prisonnier. Et voilà : elle avait servi les Allemands. « Quand même, et toi, comment est-ce que tu as pu…? – Et bien, j’ai dit qu’on habitait Redon, que je ne t’avais pas vue depuis deux ans. » C’est incroyable…
Bon, je vais arrêter là l’histoire de ma vie. Je n’en suis encore qu’à vingt-quatre ans…
(1) En ce qui concerne la Résistance, voir, dans la catégorie « Documents », l’article « La Résistance ».