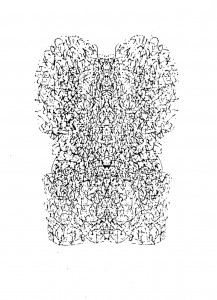Tenace ami l‘effarente nouvelle
Témoigne pour Enée rare dormeur
Un sourire allégit nos sept corps orgueilleux
Laisse l‘invisible enfant revenir.
Tristement, il regarda la nasse, à ses pieds, dont l’eau du fleuve avait distendu les joncs rouges. Depuis des mois, il redoutait la catastrophe, depuis des jours il l’attendait pour le lendemain. Catastrophe, la perte d’un instrument de travail ? Non pas. Si pauvre qu’il fût, ne pouvait-il pas s’en payer un autre ? Mais il n’irait jamais contre le signe. Un pacte était conclu entre Quelqu’un et lui, Quelqu’un qui n’était peut-être que Quelque chose mais qui, pas une fois, ne l’avait trahi. Il ne prendrait pas l’initiative de la rupture.
Allons! Le plus dur ne serait pas de quitter l’île et la cabane abandonnée; comme cette bicoque l’avait attendu ici, une autre, il le savait, lui était destinée ailleurs. Et quelque instrument de travail, qui ne serait sans doute pas une nasse mais une aiguille ou un fusil. Mais qu’il est difficile de quitter un ami, alors même que cent autres amis, de l’autre côté de l’eau ou derrière la forêt, vivent de vous attendre! Car ils ne sont pas coupables, ni lui, ni eux, et il n’est pas possible de vivre sans amour.
Longuement, il siffla, de retour dans la pièce unique où il ne faisait pas de feu. Le rat sortit de son trou et, tout de suite, s’élança vers la main nue, offerte, qu’armait d’ordinaire un bout de pain. Renifla, le poil en bataille. Dans les yeux jaunes brilla une lueur méchante. Le …? « Si je savais quoi, dit l’homme, si je savais quoi! » Les faibles seuls croient que l’amour est faiblesse. « Tu peux mordre ma main, la déchirer. Je ne t’en aimerai pas moins; ni toi non plus, malgré la déchirure, tu ne t’en aimeras pas moins, car tu es égoïste, comme tous les préférés, et je ne peux te donner tort de me haïr puisque je t’ai sifflé en vain ». Le …? Non. Ni cruauté ni indulgence. Ce n’est pas encore le jour.
Ecoute, rat, une dernière fois, ma vie. Elle est semblable à quelque belle image, ronde afin que tu puisses en mordre les coins. Depuis l’époque où je suis sorti du tunnel que je croyais sans issue, qui peut-être n’avait pas d’issue, que j’ai dû forer moi-même, sitôt qu’il m’est poussé des ongles, et sans doute plus tôt, avec mes bras, mes pieds, mon corps, boule-balle sans cesse projetant son effort vers la muraille lisse (mais non pas : contre, oh! Non, je n’ai jamais dit « contre »), depuis que je suis sorti vivant de la mort, je cherche le …, que je ne nomme pas. Car nommer, c’est trouver et parfois dans l’erreur; mais aussi ma peur de me tromper était plus forte, est toujours plus puissante, que mon désir de le découvrir. Donc je ne nommerai pas, ni le … ni ma vie. Si je pouvais la nommer, te la raconter vraiment, ne serait-ce pas que j’aurais trouvé ma limite, mes chaînes, ou que tu attendrais de moi autre chose que du pain ?
Noire de poils et de glaise, sa main lourde effleura la tête du rat. Le rat ne la mordit pas. Une étrange bouffée de joie, un instant, dissipa le scepticisme de l’homme. Si j’avais pu demeurer en ces lieux plus longtemps, sans doute aurais-je trouvé… Mais ce n’était pas à lui d’en décider : le pacte n’autorisait aucune tricherie de cet ordre. Voilà que je pars au moment même où mon ami n’avait plus besoin de pain pour se plaire à ma caresse, où l’ami voulait bien que nous cherchions ensemble. N’était-ce donc pas une nouvelle suffisante ? Et son inattendu n’autoriserait-il pas, pour cette unique fois, ma désobéissance ?
Tentation pareille à celle du sommeil, en plein jour, appelé non par la fatigue, membres las, détendus, mais par la trop grande vigueur, l’affolement de se mouvoir à vide dans un monde qui, certes, n’a pas été fait pour nous, sommeil-prison, sommeil-fuite, comme si, soudain, ivre d’aller toujours plus loin sans rencontrer d’obstacle, le désir de liberté ne tendait plus qu’à prendre forme, entre des murailles bien fermées, et proches, toujours trop éloignées et trop ouvertes, seraient-elles vêtement, ou coquille d’œuf, ou peau. Tentation de s’incruster dans cette illusion de bonheur que donne une tête rase et rugueuse, qui ne se retire pas.
Pourtant, on sait que c’est un leurre. Comment ne le saurait-on pas ? Combien de fois ai-je hésité de même, dangereusement tenté de surseoir ? On ne demande qu’un quart d’heure encore, mais, durant ce quart d’heure, d’autres raisons surgissent de ne pas déserter. Car l’esprit, durant ce quart d’heure, a transformé le sens et le signe des mots. Obéir sonne comme fuir, abandonner comme persévérer. Et c’est vrai que je pourrais, sans nasse, prendre des poissons, et c’est vrai que l’ami, par ma faute, si je pars, tournera désormais dans le cercle du souvenir. Je lui manquerai demain. Pourquoi tout cela, pour … ? Pour que Quelqu’un, ou Quelque chose, que j’ignore, continue de prendre soin de moi, de me rassasier à ma faim et de m’offrir, de loin en loin, avec un geste qui l’éloigne, la pâture rare d’un silence heureux.
Enfant, j’avais des innocences dont on riait, dont on ne rit plus mais qui blessent. L’important serait de les avoir encore ? Je l’ai cru longtemps, je l’ai cru. Pourtant, la gentillesse emprunte un masque veule; obtenir en plaisant ce n’est pas jouer le jeu. Et l’on mérite bien, parfois, la rebuffade qui glace et qui raidit. Si tu m’avais mordu, rat, je serais déjà loin, sans rancune, sache-le, sans colère, homme de nouveau, et toute chose en place. Qui donc peut s’éloigner de sa ville natale, aussi longtemps que l’eau ne l’a pas submergée, que l’incendie n’a pas arraché ses toitures, l’habitude ou les laves pétrifié ses morts ?
Rapide, la main de l’homme s’est de nouveau posée sur la tête du rat. Et, cette fois, lourd de quels rêves lui-même, ou irrité par la monotonie de la voix, l’animal a réagi. Les petites dents blanches ont attrapé la chair et s’y sont enfoncées. Rageuses, elles ne lâchent pas prise avant qu’elles n’aient arraché leur morceau de chair. Cela est meilleur que le pain, et meilleur que l’amitié même : terrible don d’une douleur à l’état pur! L’homme rit en regardant sa main qui saigne, en regardant le rat manger le petit morceau de main qu’il lui a prise, qu’il lui a dérobée avec violence, comme il convient qu’agissent la faim, l’amour et la mort.
Des bruits lui viennent du dehors : chute d’une feuille, galop d’un coursier. L’eau du fleuve, par lames courtes, pénètre dans la nasse qu’elle achève de détruire. Le cheval est de l’autre côté de l’eau, maintenant arrêté parce que l’herbe est haute et verte. Un oiseau a chanté. Que peux-tu contre moi, sommeil, contre cette plaie béante qui étoile cinq rayons, vers chacun de mes doigts ? Adieu, ami, demain tu dormiras, repu, et ne souffriras même pas de mon absence, puisque, en buvant ce tout petit peu de sang, tu m’as délivré du sommeil, pour t’en charger. Mon orgueil reconquis m’assure que ton destin a moins d’importance que le mien.
Un cheval noir : il doit avoir une tache blanche au poitrail. Le … s’éloigne. Peut-être n’a-t-il jamais eu d’existence, peut-être n’est-il que le contenant de toutes les choses nommées et qui, parce que nommées, sont. Le …, conque vide, où attendent de naître les choses : un arbre, un fleuve, une nasse, un cheval. Un … rat. Non! Pas encore! Dans un jour, ou dans une semaine, peut-être, l’indétermination aura cessé d’être un blasphème. Pour l’instant, sois encore le … rat, puisque, de nouveau, me voici prêt à basculer dans l’innommé, en proie à cette terrible crainte de laisser derrière moi ce que je vais chercher ailleurs, sacrifiant le connu, l’aimé, l’admis, à l’impérieux besoin d’imposer ma présence à tout ce qui, soudain, me semble vide sans moi; le rat à un cheval.
Sabrant l’eau de ses bras immenses, il rejette à sa droite, à sa gauche, les flots enveloppeurs; c’est comme si, pour la seconde fois, il éloignait de lui les tentations de l’amour et du sommeil, mais dans la joie, cette fois, sans regret, sans souillure, progressant hardiment de refus en refus, poussé de plus en plus loin, propulsé par ses refus mêmes, jaillissant de chaque vague comme de son passé. Inutile, chassée par sa vigueur, la douleur vive s’est apaisée. Lorsque son bras gauche s’étire, il a un regard vers le cœur rose qui s’y peint, et sourit.
Allègre, il repris pied sur la grève, d’un seul élan a enfourché le cheval noir. Le torse droit, les cuisses dures, il respire et attend. Le cheval n’a pas bougé. Il tend le cou et mange, il déchire l’herbe comme le rat une main, en imitant le même bruit menaçant et tranquille que fait un oiseau qui se laisse tomber du ciel, ses grandes ailes déployées. La longue crinière penchée ressemble à s’y méprendre à un escalier d’algues, le long d’une roche noircie par le sel, et la mer au pied. Nul poids, nulle fatigue. Lorsque l’on part, c’est bien connu, tout ce qu’il laisse derrière lui allège le voyageur d’une masse équivalente à ce qu’il quitte, une maison pesant moins qu’un rat. Que te voilà léger sur ton grand cheval noir; serre les cuisses, cavalier, si tu ne veux pas t’envoler, tout à coup, parmi les nuages et les feuilles. L’animal qui te porte, et qui broute, ne te sent pas sur son dos. Ne crains-tu pas d’être déjà semblable à celui qui a tout quitté, pour toujours, et que les vivants ne voient pas, lorsqu’il les suit, en craignant de les troubler par un bruit de chaînes, dans les méandres des couloirs hantés ? Ton corps ne serait-il pas resté au fond de la rivière; y a-t-il autre chose sur ce cheval que ta volonté d’y monter, plus ténue mais aussi plus tenace que le parfum qui s’élève de la fleur écrasée ?
Non. Le cheval s’est redressé. Il hennit. Ce n’est pas une clameur furieuse, ce n’est pas non plus un vibrant accueil. Un étonnement inquiet ralentit cette plainte, l’allonge étrangement. Les naseaux grands ouverts, les pattes arc-boutées, l’animal, lentement, creuse ses reins; attentif, il suppute à son poids la nature de l’être qui l’assujettit. Et, brusquement, bondit, traversé d’un frisson. Oh! Bon combat! Nous sommes deux. Ta révolte m’annonce une amitié durable, la prise de toi que tu m’as permise t’apprend que je sais aimer. Soumets-toi à la rage qui te jette en avant, mieux isolé du monde que par des œillères, plus ferme en ton dessein que si un mors te sciait les dents. J’aime ton ardeur à me fuir; j’aimerais de même que, me jetant à terre, tu piétines mon corps confondu à l’herbe que tu foules. Car la violence, qui rend le départ plus facile, fait aussi tout le prix de l’accueil. Je te plains de ne pas savoir encore que je t’aime.
Silence. Paix des ondes qui se sont tues. Quoi de plus silencieux que le galop d’un cheval après le grignotement d’un rat ? La mort de même doit être muette, qui vient à l’improviste. A moins que, jusque dans la mort, le nombre ne s’impose et ne frappe en cadence, en même temps que la terre, l’esprit qui a besoin d’un métronome pour s’ouvrir. Le lundi, autrefois, c’était l’école et, plus tard, le bureau. Le mardi, la leçon pas sue, le livre de comptes aux mains de la ménagère, et de l’argent à redonner. Le mercredi, la pluie, ou pire, le soleil qu’on voyait derrière la fenêtre alors qu’il restait une page à finir. Le jeudi, les enfants envahissaient la pièce où je faisais semblant d’envier la solitude. Le vendredi, déjà, la peur de n’avoir plus rien à dire, et le samedi, cette peur accrue. Mais le dimanche, oh! Le dimanche! qu’il y avait donc de raisons pour se briser la tête contre les pierres, depuis la messe du matin jusqu’aux conversations du soir! Nombre effrayant de ma vie, je te hais, parce qu’on ne m’a jamais appris à vivre sans cadence. Je te hais, cheval, tout à coup, toi dont le pas septénaire, alors que je rêvais de courses et de libre espace, m’enchaîne à l’éternel recommencement…
Comme ton corps s’est vite habitué au mien! Que notre danse est gracieuse! Hélas! Je la rêvais insolite et brutale, disproportionnée. Mon corps se suffit à lui-même. Je n’ai que faire d’un autre corps qui le complète et l’annihile. Il ne me faut qu’un adversaire pour définir ma puissance. Mes cuisses ne sont pas comme l’outre qu’on fit pour que du vin l’épouse, mais, pierres, elles veulent heurter une pierre-sœur afin que d’elles le feu jaillisse. Mes bras ne sont pas des rubans à t’embellir le cou mais un étau qui, s’il ne brise, doit du moins modeler dans l’effort. Ma poitrine résonne quand je la frappe.
Or, j’attendrai longtemps cette douceur de vaincre. Je le sais, ce n’est pas pour aujourd’hui. Jamais je ne rencontrerai un adversaire qui me vaille. Déjà, toi-même, te voilà dompté, pourtant si beau, de loin, si fier. Est-ce donc vrai que ton œil ne peut pas me voir à ma taille, mais beaucoup plus grand que je ne suis ? Je ne voulais pas te mentir. A travers toutes ces aventures où je me glisse, penses-tu que je ne souhaite qu’être admiré ? Peut-être moi aussi, ai-je quelquefois envie qu’on me plaigne et me soigne. Je suis las de toujours devoir vous mériter, images de moi-même que se font mes conquêtes, las plus encore, sans doute, de l’image de moi-même que je me fais, en fuyant la candeur, en aimant la souffrance, en traversant un fleuve, en domptant les chevaux. Je l’avais oublié, mais c’est vrai que la fuite est une épreuve aussi. C’est vrai qu’on peut, un jour, ne plus partir pour se vaincre mais pour savourer sa victoire. C’est vrai qu’on peut se plaire à chaque pas qu’on fait, et tant aimer l’élan qu’on en oublie la cible. C’est vrai que s’arrêter exige du courage.
Libre de regarder l’homme qui le montait, le cheval, enfin, tourne la tête, le regarde et s’ébroue, piétine longuement. Cet étonnement, muet et triste, comme il est plus poignant que l’autre, celui qui n’était qu’une attente! Pourquoi cette prise parfaite, pour un si rapide abandon ? Pourquoi tant de vigueur, si vaine ? Pourquoi m’être venu chercher ? La tête noire s’approche, elle va toucher l’homme au bras ou à l’épaule, et l’homme sait, si la tête noire le touche, qu’il va se laisser émouvoir. Il retire son bras, le retient, le balance, de toutes ses forces frappe l’animal aux naseaux. La rançon de l’amour est payée, vengée l’ancienne injure. Maintenant, tu peux partir. Maintenant, tu pars. Sans raison, je t’ai pris, je te quitte sans raison. Que de mots seraient nécessaires pour faire entrer en ta cervelle étroite l’équivalence de cette meurtrissure ? Assez! L’orgueil a débordé les rives raisonnables, où coule un flot qui ne doit rien à l’orgueil ni à la raison. Seul le flot me lave, sais-tu ? Le …
Le flot. Brusquement accordée, récompense immanente, l’évidence baigne comme une eau. Il coule, chaud entre les doigts, le sable. Le cheval court au loin. Un ver force son chemin dans le sable. Criante, une mouette vole au loin. La froidure du soleil couchant ne fait pas moins chaud le sable. C’est à cause de la couleur rouge qui s’étend loin. Le rouge donne chaud aux hommes comme au sable. La couleur rouge avive les blessures.
Il s’est couché de tout son long sur la plage, stupéfait que la mer, tout à coup, soit proche. Le flot est infini, comme l’esprit d’un homme qui ne cherche plus à comprendre. Barreau, plume, chiendent, grain de sable aussi bien, le … est là, identique seulement à ce qui est, hors du nombre et de l’heure. Moi, aussi bien. Pourquoi, et depuis quand est-ce que je crains l’erreur ? Ce qui est unique ne peut pas tromper. Ni ce sable, ni cette eau,, ni cette main chaude qui fouille dans les profondeurs du sable, à la recherche d’un peu de fraîcheur.
En vain; la chaleur est en lui. Elle ne provient ni de la couleur du soleil couchant, ni de la lourde journée qui s’achève. Enfant, ainsi, parfois, je rendais toute chose responsable de ma paresse ou de ma mauvaise humeur. Mais toutes les choses, partout, étaient laborieuses et gaies, sauf à l’instant où la petite flamme qui les irradiait, avant de disparaître, flambait une dernière fois, très fort. L’enfant n’avait pas tort d’être indécent, mais seulement de croire que l’indécence est punie de mort. Rien n’est puni de mort, que la vie. Il n’y aura plus, c’est vrai, de nasse ni de cabane, ni de rat, ni de cheval noir qui ne demande qu’à porter. La main compatissante s’est retirée depuis, rat, que tu y as creusé ce cœur. On ne t’aidera plus à vivre un jour encore, ni même une heure. L’enfant n’avait pas tort de regretter sa mère, mais de croire, seulement, qu’elle le protégeait du pire.
Rêveur! Ne faut-il pas, d’abord, passer par le tunnel ? Et, par le tunnel, revenir dans l’antichambre de l’absence ? Ne faut-il pas cogner avec ses poings fermés, ses jambes convulsées, son corps immense, contre les murs qui ne sont pas faits pour s’ouvrir ? Ne faut-il pas s’arracher difficilement au songe, avant de revêtir la tunique rêvée, les murs qui ne reculeront plus, la seule prison dont on ne s’échappe point, plus compatissante qu’une main, plus étroitement resserrée qu’une coquille d’œuf, plus prenante et mouvante et plus libre que l’eau? Il sait maintenant de quoi le rat va mourir.
Jean-Charles Pichon
1954